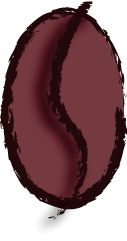 |
Café'in... Les archives de nos débats...27 Mars 2004 : Jardins...le temps retrouvé ?
|
 |
Philippe Sahuc, à gauche, Dominique Dupouy au centre. |
|---|
Retrouver ses racines dans son jardin...? Le sociologue Philipppe Sahuc fouille le passé du jardin familial pour remonter au potager ouvrier accordé par la Compagnie des Chemins de Fer à son arrière-grand-père cheminot.
Retrouver un temps révolu... ? Que recherchent ces nouveaux jardiniers de Tournefeuille qui renouent avec cette tradition du jardin ouvrier communautaire? Une alimentation naturelle, seulement ? Ou la redécouverte de rythmes profonds oubliés, de ce temps perdu dans les trépidations de la vie moderne, la sociabilité aussi, comme dans les espaces verts, les jardins publics de nos villes?
Jardins... Le temps retrouvé?
Invités :
- Philippe Sahuc, sociologue, auteur de "Archéo...logis avec jardin"
- Dominique Dupouy, présidente de l'association "Les Jardiniers de Tournefeuille"
L’animateur était Michel Sarrailh
| Philippe Sahuc | Il a écrit un livre "Archéo...logis avec jardin" dont il lira quelques extraits au cours du débat. Celui-ci retrace l'histoire du jardin familial dans le faubourg Bonnefoy à Toulouse. Son arrière-grand-père est venu de sa montagne catalane pour travailler à la compagnie des Chemins de Fer et a obtenu de celle-ci, une parcelle à cultiver. Puis ce jardin a été racheté par ses descendants qui y ont construit leur maison. C'est dans ce jardin de ville que Philippe Sahuc a découvert la nature quand il était petit et qu'il aidait son grand-père. "Les maladies infantiles m'ont transporté. C'est près du jardin qu'on guérissait" (extrait du livre). Il s'agit donc ici d'une histoire personnelle lue à la lumière de la sociologie et de la littérature. La terre n'était pas une bonne terre à cultiver. Mais Toulouse était rurale à l'époque et l'on y élevait volailles et porcs. Chaque dimanche, Philippe Sahuc devait aller emplir la comporte en circulant dans le quartier pour recueillire le lisier pour le jardin. Ainsi la terre jaune originelle devint-elle noire et riche de matière organique. C'est de ce jardin qu'il a hérité. Traditionnellement, les jardins ouvriers étaient décrits comme individualistes. Toute une génération de sociologues a refusé de s'occuper de ces jardins considérés comme des entreprises de main-mise du patronat sur l'ouvrier. Et effectivement, l'origine en est paternaliste. Créés dans la région du Pas-de-Calais par un abbé fin XIX°, ils étaient un moyen de contrôle social sur les ouvriers. Ils n'iraient pas ainsi au café, ne parleraient pas de politique pendant qu'ils seraient occupés dans leur jardin qui leur prendrait du temps après leur travail en usine. |
| Dominique Dupouy | C'est la même chose qui s'est passé au Château d'Arc et Senans dans le Jura. Les ouvriers habitaient autour du château et avaient leur jardin. Il y avait vraiment une volonté d'avoir ses ouvriers sous la main. |
| Philippe Sahuc | Dans les années 1980-1990, les sociologues ont redécouvert dans ces jardins des pratiques d'échanges. En fait, malgré cet individualisme, chacun se retrouvant sur son lopin de terre, se créaient des liens entre les gens à partir du jardin : échanges de graines, de trucs, etc. |
| L'animateur | Il a eu le même vécu dans son enfance quand il jardinait avec son père. Mais c'était le bagne pour un enfant lorsqu'il devait transporter des poids, de gros arrosoirs par exemple. Il y avait toute une récupération de matériaux de l'usine où son père travaillait, de l'alu pour faire les rames par exemple. Tout un art du recyclage. Le jardin prolongeait l'usine en quelque sorte ? |
| Philippe Sahuc | Effectivement, le jardin était un prolongement de l'atelier. Le terme "atelier" était employé par le grand-père pour dire "usine". Recyclage en effet et aussi souci de l'étiquette chez le grand-père : il ne fallait pas qu'un brin de mauvaise herbe dépasse dans les cultures. |
| Dominique Dupouy | L'association "Les Jardins de Tournefeuille" dont elle est la présidente n'a que six mois mais déjà soixante adhérents. Au départ, un petit groupe de quatre à cinq personnes avec jardin. Elle : son grand-père avait un jardin ouvrier et effectivement, elle a noté cette recherche de l'étiquette. Il faisait la chasse aux mauvaises herbes. Elle a eu envie de transmettre à d'autres ce qu'elle avait appris avec lui. L'association a obtenu de la mairie un terrain de 15000 m2, une clôture et un raccordement à l'eau et à l'électricité. Elle projette l'utilisation d'un puits pour ne pas utiliser l'eau de ville. Le projet est d'avoir un lieu convivial, un lieu de vie, ouvert à toute personne qu'elle ait un jardin ou non. L'objectif est de socialiser des personnes non intégrées dans la cité. Beaucoup de femmes seules, des familles monoparentales font des demandes. Les membres de l'association ont visité des jardins comme ceux de La Faourette qui sont très bien. |
| Intervention | On y reconnaît des jardins de cultures diverses, d'origine marocaine ou asiatique. Chacun a sa spécificité. C'est ce que l'association voudrait développer à Tournefeuille, la diversité et les échanges. |
| Dominique Dupouy | Tous les jardins familiaux que les membres de l'association ont visités, n'ont pas cette optique de socialisation et d'intégration et ont même des attitudes de rejet raciste envers certaines populations. 20% du terrain est une zone inondable et ce terrain fait partie de la coulée verte de Tournefeuille. |
| Intervention | Il y a une volonté actuellement dans les municipalités de préserver les zones vertes, humides. On intègre de plus en plus des jardins et des paysages dans la ville. Tournefeuille doit devancer l'urbanisation à long terme. |
| Dominique Dupouy | Un projet au Sénat va voir le jour pour protéger les jardins familiaux, pour que l'immobilier ne prenne pas le dessus. Il faut une garantie de perennité une fois qu'un jardin familial s'installe. |
| Intervention | Il doit y avoir des rotations ? Les gens ne restent pas indéfiniment ? |
| Dominique Dupouy | Oui, il y a des rotations lorsque les gens sont obligés de déménager mais en général, ils ont du mal à repartir une fois qu'ils sont installés. |
| Intervention | Il y aura des allées communes ? |
| Dominique Dupouy | Ce seront des parcelles comme à la Faourette, avec des cabanons tournés vers une placette. Au milieu, il y aura une partie commune où les gens pourront prendre des repas en commun. |
| Intervention | C'est vous qui avez fait le plan? |
| Dominique Dupouy | Un dossier a été monté nous avons obtenu des aides de la Fondation de France et du Conseil Régional. Car les cabanons sont chers. |
| Intervention | Quel est le prix minimum pour la location? |
| Dominique Dupouy | Pas plus de 100 euros par an en fonction de la surface. Certaines personnes obtiendront des aides financières des associations humanitaires. |
| Intervention | Avez-vous pensé à faire une étude de pollution? Car j'ai été confrontée au cas d'un jardin sur un site pollué et cela faisait des années que des gens y cultivaient leurs légumes. Le scandale a éclaté lorsqu'il y a eu une inondation et que cette pollution a été dénoncée. |
| Dominique Dupouy | Oui, il est prévu une analyse des sols. Le terrain se trouve dans la zone inondable du Touch et la mairie l'a racheté à son propriétaire. Mais nous allons éviter de prendre l'eau dans le Touch en creusant des puits. |
| Intervention | Il faudrait faire des puits à 6-8 mètres de profondeur. |
| Philippe Sahuc | Dans les années cinquante, qui fut un moment-clé pour le jardin de mon grand-père, puisqu'on a changé les habitudes et qu'on n'a plus utilisé le puits, la nappe phréatique s'est déplacée. Depuis, il faut utiliser l'eau de la ville, ce qui n'est pas pareil. |
| Dominique Dupouy | Nous allons également proposer aux écoles une parcelle avec une serre pour l'hiver. |
| Intervention | Comme à Castanet et à Ramonville où il porte le nom de "Jardin des senteurs et des couleurs". Il est curieux d'ailleurs de constater qu'il n'y a aucune dégradation alors qu'il n'est entouré d'aucune clôture. |
| Intervention | Il y a aussi un arboretum. |
| Dominique Dupouy | Nous pensons qu'il est important que les enfants voient leurs parents travailler car dans la vie quotidienne, ils les voient après le travail et jamais au travail. |
| L'animateur | À partir des années soixante, il y a eu un basculement. Le jardin potager a été remplacé par la pelouse. N'y a-t-il pas actuellement un frémissement vers un retour au jardin potager? |
| Dominique Dupouy | Les gens sont en train de passer du quantitatif au qualitatif. |
| L'animateur | Mais les traditions n'ont-elles pas été perdues? |
| Dominique Dupouy | C'est justement dans les jardins familiaux que l'on peut se transmettre des recettes, retrouver la culture des plantes du passé, oubliées au fil du temps. |
| Intervention | Ce n'est pas à priori négatif car une clôture fait la part entre l'ouverture et la limite mais il ne faut pas qu'elle soit trop haute, il faudrait qu'elle suggère, qu'elle symbolise un espace individuel. Oui, dans l'Atlas, les jardins ne sont jamais matérialisés. On peut ainsi pendant des randonnées, suivre des chemins qui longent des jardins en terrasse. De petites séguilhas délimitent les ruisseaux. Près de Fès, il n'y a pas de clôtures, seulement des oliviers, parfois de petits murets. |
| Dominique Dupouy | Dans chaque jardin, les plantes ont une histoire. Elles ont souvent été données par quelqu'un ou les graines ont circulé. Nous allons cultiver de manière naturelle sans tomber dans le bio à tout prix, mais sans engrais, avec un composteur, un coin avec des orties. |
| Intervention | Nous réfléchissons à des haies pour attirer des insectes et nous avons fait un tracé de mare. |
| Dominique Dupouy | Nous allons obtenir du fumier des haras et du compost des déchets verts de la commune. |
| Intervention | Le chapardage? |
| Dominique Dupouy | Oui, ça arrive. Mais il faut en parler avec les personnes qui chapardent. Attention à ne pas mettre un gardien comme cela se fait dans certains jardins familiaux car on note alors des réactions agressives, une mauvaise ambiance. Il vaut mieux agir par l'exemple, à la fois pour prouver que des plantes peuvent pousser avec des méthodes naturelles et responsabiliser tout le monde. Il est important d'accepter toutes les cultures à tous les sens du terme : cultures de plantes et manières de cultiver différentes selon son origine culturelle. |
Compte rendu du débat par Nadine Lanneau, secrétaire de Café’In
- L'association a créé un "Café Botanique" Tous les seconds vendredis de chaque mois à 20h30 au Cinéma l' "Utopia", les membres de l'association se retrouvent pour échanger autour de thèmes comme les engrais, les végétaux, les traitements naturels...Prochains thèmes :
- 9 avril : Connaissez-vous les légumes et les fruits d'antan ?
- 14 mai : Comment accueillir la petite faune utile dans votre environnement ?
- 11 juin : Quelle est la place de l'eau dans le jardin ?
- Conférences et cours de taille
- Visites chez des producteurs
- Expositions
- Trocs de semis, de boutures, de plantes le 24 avril.
